Une réflexion du fr. Óscar Martín Vicario, Conseiller Général

Une chose que l’on ne m’avait pas dite lorsque j’ai commencé mon mandat de Provincial, il y a quelques années, c’est que je devrais accompagner de nombreux Frères à l’hôpital, dans leurs crises, dans leurs moments de faiblesse, et même dans la préparation à la mort (j’ai dû dire adieu à quarante-huit frères en six ans). Je dois admettre que ce fut une expérience difficile. Plus d’une fois, à ma grande surprise, j’ai été envahi par un sentiment d’impuissance et des larmes ont coulé.
Pourtant, en même temps, c’était un privilège et une grâce. Les noms de beaucoup de ces frères resteront à jamais gravés dans ma mémoire, surtout ceux dont la perte a été la plus douloureuse, comme Miguel, César, Antonio, Augustin, Carmelo… Partager leur douleur et leur souffrance, leur peur et leurs adieux a été un exercice de présence, de patience, de compassion, d’écoute et de beaucoup d’apprentissage. Je remercie Dieu aujourd’hui pour le privilège de ces rencontres.

IL LEUR MONTRA SES BLESSURES
Ces souvenirs sont revenus ces jours-ci, en lisant les beaux récits d’après Pâques, dans lesquels la question de l’identité du ressuscité est posée à plusieurs reprises, et qui soulignent le désir des disciples de Jésus de démontrer que la personne qu’ils ont rencontrée face à face était vraiment Jésus. L’un des moyens utilisés pour décrire leur expérience est que Jésus « leur montra ses plaies » (Jean 20, 20), afin de dissiper toute incrédulité.
Cette phrase, je l’avoue, m’a fait grimacer lorsque je l’ai mé-ditée ces jours-ci : « Il leur montra ses plaies ». Qu’il est beau ce paradoxe qui parle du ressuscité triomphant ! Il ne leur a pas d’abord montré ses miracles, ou sa force, ou sa puissance. Il ne les a pas convoqués dans un lieu mystique et magique, ou au temple, mais dans la vie quotidienne de la Galilée. Il ne leur a pas révélé son identité avec des arguments rationnels… Il leur a seulement « montré ses blessures ».
Dans les moments de désarroi, de vulnérabilité, cette scène me touche et me pose des questions. Moi qui suis une personne au caractère bien trempé, avec une tendance à être plutôt sûr de moi et déterminé (du moins « à l’extérieur »), je me sens invité, à ce stade de ma vie, à montrer mes blessures, à laisser les autres voir où et de quelle manière je suis faible, à ne pas cacher mes échecs ou dissimuler mes limites comme je l’ai parfois fait. C’est là, plus que dans mon orgueil ou mon arrogance, que je cache (et pourtant montre) qui je suis vraiment, ma véritable identité. Pour exprimer notre fragilité contemporaine, combien est inspirante et évocatrice l’image d’un foyer ou d’une maison « sans murs », où je vis et où nous vivons tous aujourd’hui (et sur laquelle une connaissance de Valladolid, le bibliste Víctor Herrero, a récemment écrit un très beau texte).
Oui, j’ai des blessures. Oui, j’ai eu peur lors de la pandémie. Oui, mon cœur a été déchiré par la perte de personnes que je connaissais. Oui, j’ai eu peur de ce qui se passerait si j’étais infecté. Oui, je vis dans l’inquiétude pour ceux que j’aime. Oui, ma foi n’est pas assez forte pour faire face à tout cela. Oui, dans ce contexte, vivre en fraternité est devenu plus difficile. Oui, j’ai du mal à demander de l’aide et à dire « je suis mal en point », « je ne comprends pas », « j’ai mal »… Et, je dois l’avouer, je suis même surpris quand j’entends certaines personnes, dans des moments comme celui-ci, dire « Je vais très bien », « Tout va bien pour moi », « Je vais très bien ». Eh bien, ce n’est pas le cas.
Aujourd’hui, je préfère le Jésus qui « porte ses blessures » : en lui, humain et meurtri, je me sens plus compris. Il y a quelques années, j’ai entendu Jon Sobrino, un théologien jésuite basé au Salvador, dire : « N’oublions pas que le ressuscité est le crucifié… mais aussi l’inverse, que le crucifié est le ressuscité. Et il n’y a pas d’autre lieu de rencontre avec Dieu que dans chacun des peuples de la terre crucifiés, écrasés, souffrants. »
C’est pourquoi, en ruminant ces derniers mois, je m’identifie de plus en plus au Champagnat qui est allé pleurer à la chapelle de Notre-Dame de la Pitié parce qu’il était effrayé à l’idée que sa fondation périclite sans vocations ; à l’homme qui s’est levé mollement de son lit de malade pour soutenir ses frères ; avec l’homme qui se demandait, assis près du Gier, si l’œuvre de sa vie était l’œuvre de Dieu ou s’il valait mieux abandonner ; ou avec l’homme qui tombait dans la neige, ses forces déclinant, et levait les yeux à la recherche d’une lumière (qu’il ne devait trouver à l’extérieur que lorsque la foi l’allumait de l’intérieur).
Je trouve difficile de me laisser laver les pieds. Et que les autres voient ma pauvreté et mes limites. Mais montrer mes blessures est l’invitation du Ressuscité. Parce que, comme le pape François l’a dit avec sagesse le dernier dimanche des Rameaux, « Dieu est avec nous dans chaque blessure, dans chaque peur ».
KINTSUGI
Dans cette veine, j’ai été fasciné par le message d’un frère et ami qui me parlait de “kinti”. Je n’avais aucune idée de ce que c’était, et peut-être que cela fait de moi un ignorant car c’est un art vieux de plusieurs siècles… Mais, avec ses connotations pascales, il me semblait que c’était quelque chose de nouveau et de provocateur : il s’agit d’une technique japonaise de réparation des vases cassés, qui consiste à assembler les pièces et à refaire les vases à partir des différents morceaux (y compris certains précieux), pour en faire un tout artistique, mais dont les fissures restent visibles. De cette façon, les défauts, les imperfections et les lignes de fracture deviennent les plus belles caractéristiques du récipient rénové. Non seulement ils ne sont pas cachés, mais ils sont embellis par l’or.

Un art magnifique, le kintsugi. Comme j’aimerais apprendre à le maîtriser dans ma propre vie et dans les moments de deuil ! Apprendre à regarder tout le monde avec les yeux de ces artisans japonais qui voient dans les brisures une grâce et dans les fractures des occasions de réparer.
Lors d’un récent symposium de l’Association St Marcellin Champagnat d’Australie, le dominicain Timothy Radcliffe a proposé la même chose en nous invitant de manière surprenante à être des « jardiniers de la vie », c’est-à-dire à aider à guérir, à survivre aux échecs, à fournir de l’oxygène vital, comme l’a fait le Dieu incarné, guérisseur et libérateur, toujours proche des blessés et des pauvres.
Mon humble prière de Pâques : Apprends-moi, Seigneur, à laisser voir mes blessures. J’ai besoin d’oser sans honte défier les convenances et d’être comme ceux (Nicodème, la femme hémorragique, Zachée, la femme adultère…) qui se sont approchés de toi, craintifs et faibles, tremblants, mais prêts à se tenir devant toi et devant le peuple « montrant leurs blessures », leurs peurs et leurs douleurs. Donne-moi et donne-nous, Seigneur, la force de la faiblesse. Le sourire d’un enfant malade. La provocation de sœur Ann Un Twang qui a désarmé les soldats du Myanmar uniquement en s’agenouillant et en pleurant. La sage théologie de la lenteur, dont parle le cardinal Tolentino. La prophétie des petits. Le pouvoir du fumier.
Le Ressuscité leur a montré et nous montre ses plaies. « C’est Lui ! », ont-ils dit en signe de reconnaissance. C’est Lui que je veux être.
Alléluia, mes frères !
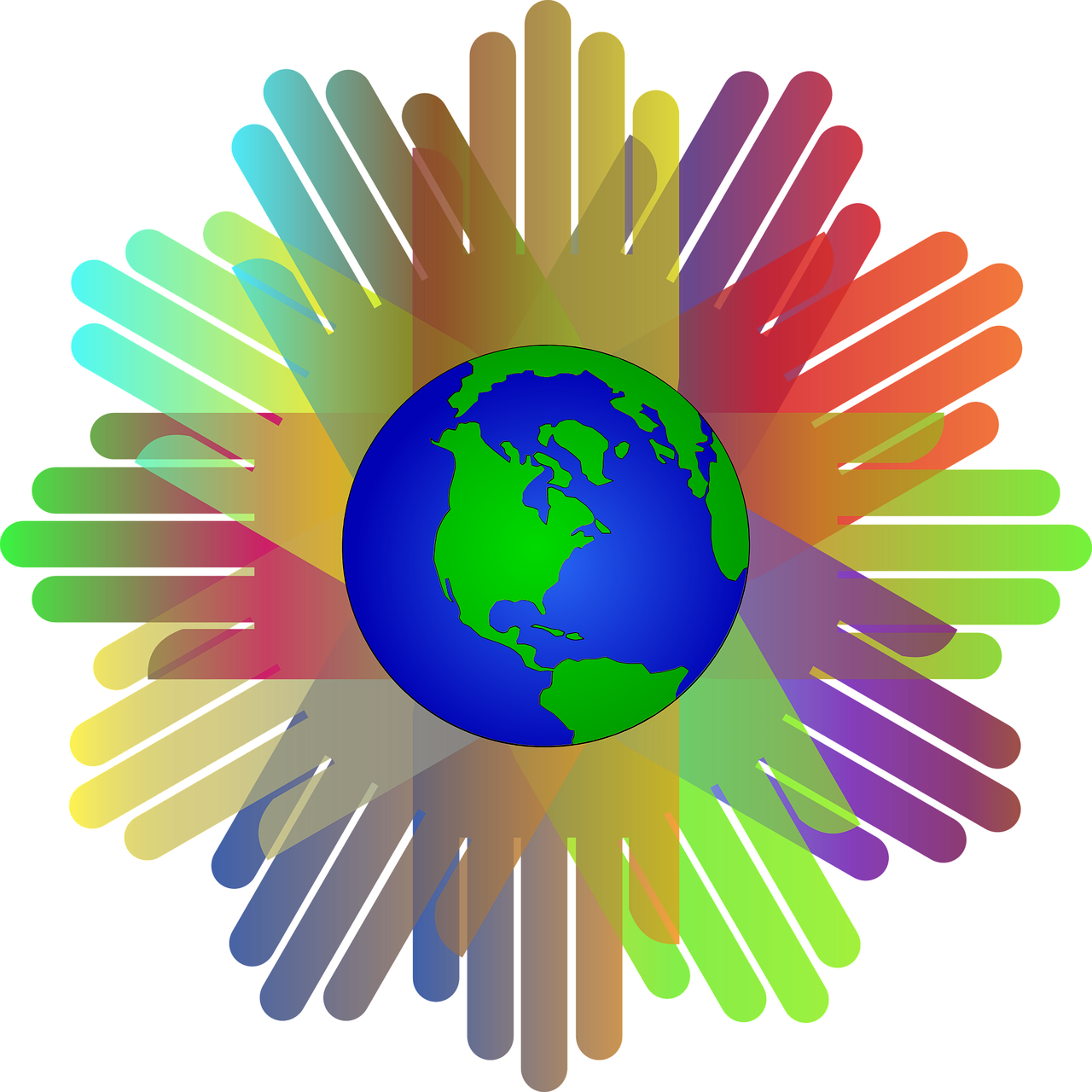

No responses yet